http://www2.ac-lille.fr/biotechnologies/annalesbio.htm
Sujet des Antilles1999 BIOLOGIE HUMAINE Les anticorps (7 points)
1 Immunologie : Lyse de bactéries
Un cobaye A reçoit par injection sous-cutanée une suspension de Vibrio cholerae. Deux semaines plus tard, son sérum est prélevé : (sérum A). Un cobaye B, non traité, sert de témoin : (sérum B).
Les expériences résumées ci-dessous correspondent aux travaux de Bordet (1895).
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
V. cholerae + sérum A |
V. choIerae + sérum A chauffé à 56°C pendant 30 min |
V.
cholerae + sérum
B |
V. cholerae + sérum A chauffé à 56°C pendant 30 min + sérum B |
|
LYSE |
PAS DE LYSE |
PAS DE LYSE |
LYSE |
1.1 Les résultats des
expériences 1 et 3 permettent de mettre en évidence une substance présente
dans le sérum A et intervenant dans la lyse des vibrions. Analyser ces expériences
et préciser la nature de cette substance.
1.2 Quel est l'effet du chauffage du sérum A pendant 30 minutes à 56°C
? Interpréter le résultat de l'expérience 2.
1.3 Récapituler les résultats obtenus en indiquant quels sont les éléments
présents dans le sérum A nécessaires à la lyse des vibrions.
1.4 Quel renseignement complémentaire le résultat de l'expérience 4
apporte-t-il ?
1.5 Elaborer un schéma concis, légendé et annoté permettant de
justifier la lyse observée dans l'expérience 4. Préciser l'origine de chacun
des éléments mis en jeu.
1.6 Elaborer un schéma concis, légendé et annoté justifiant l'absence
de lyse dans les expériences 2 et 3.
2 Structure fonctionnelle des immunoglobulines.
2.1 Titrer et légender précisément le schéma du document 2, en indiquant le nom et la nature des éléments structuraux.
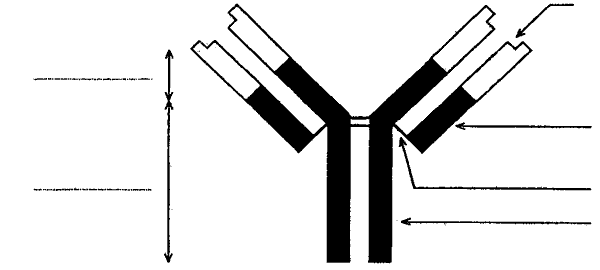
2.2 Préciser quelle région de cette molécule est impliquée dans la
reconnaissance des antigènes. Comment est appelée cette région ?
2.3 Préciser quelle région de la molécule est impliquée dans la
reconnaissance par les récepteurs cellulaires.
3 Un exemple de pathologie.
Les mécanismes immunitaires étudiés ci-dessus interviennent dans certaines
pathologies.
Après la naissance d'un premier enfant Rh+, une femme de groupe A- attend un
second enfant. Le sang de ce second enfant présente une hémolyse partielle in
utero ; les analyses montrent qu'il est Rh+.
3.1 Comment s'appelle
ce type de pathologie foeto-maternelle.
3.2 Expliquer l'hémolyse en précisant l'origine de chacun des éléments
mis en jeu.
Sujet des Antilles1999 BIOLOGIE HUMAINE CORRECTION Les anticorps
Cette correction est une aide pour vos révisions.
Les réponses sont courtes et permettent de vous orienter pour chercher les
compléments dans vos cours ou manuels.
1 Immunologie : Lyse de bactéries
1.1 L'injection du vibrion est indispensable à la production des
anticorps.
1.2 Le chauffage empeche la lyse des bactéries.
1.3 Les anticorps dirigés contre les vibrions et les fecteurs du complément.
1.4 Le complément du cobaye B peut agir avec les anticorps du cobaye A.
1.5 Vibrions, Ac du cobaye A et complément du cobaye B
1.6 Pour l'expérience 2, le complément est absent; pour l'expérience
3, le complément est présent mais les Ac anti-vibrions sont absents
2 Structure fonctionnelle des immunoglobulines.
2.1
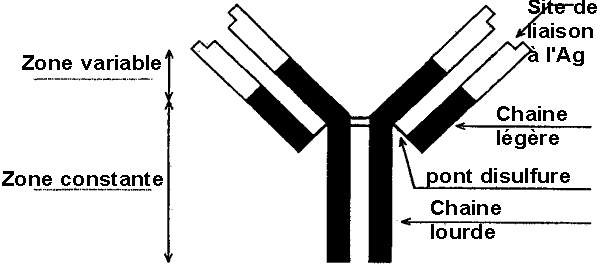
2.2 c'est la région
variable : le paratope
2.3 Le fragment Fc.
3 Un exemple de pathologie.
3.1 Comment s'appelle
ce type de pathologie foeto-maternelle.
3.2 L'hémolyse est réalisée par les Ac anti rhésus produit lors de
l'accouchement du premier enfant Rh+.
Sujet de la Métropole 1999 BIOLOGIE HUMAINE
Les coopérations cellulaires en immunologie (8 points)
1 Étude expérimentale.
Dans les expériences qui suivent, illustrées dans le document 3, on dispose de souris témoins (expérience a) et de souris utilisées pour l'expérimentation (expériences b, c et d). Des hématies de mouton sont injectées à ces souris. Après une semaine, on recherche la production induite d'éventuels anticorps par ces souris.
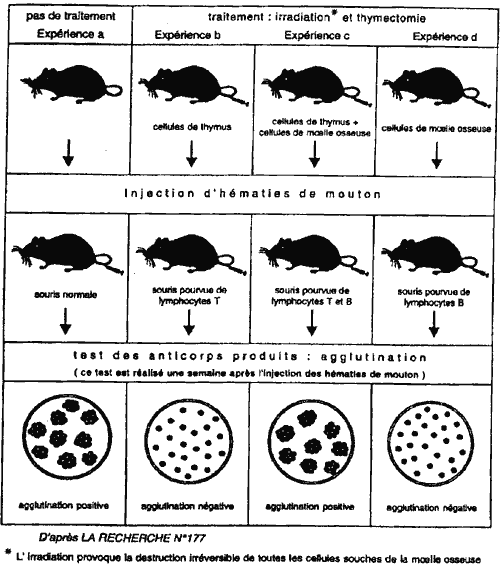
1.1 Etude de l'expérience a.
1.1.1 La recherche d'anticorps produits par la souris repose sur une réaction d'agglutination
a) Quels sont les
produits biologiques mis en présence lors de la réalisation de ce test ?
b) Que signifie pour cette expérience la présence d'une agglutination ?
1.1.2 Les hématies de mouton sont-elles immunogènes dans le cas présent ? Justifier et définir le terme immunogène.
1.2 Etude des expériences
b, c et d.
Au cours de ces expériences, on utilise des souris adultes, irradiées, et privées
de thymus par voie chirurgicale. On injecte à ces souris :
· soit des cellules de thymus d'une souris adulte saine (expérience b)
· soit simultanément de la moelle osseuse et des cellules de thymus (expérience c)
· soit de la moelle osseuse d'une souris adulte saine (expérience cl). Des hématies de mouton sont ensuite injectées à chaque souris.
1.2.1 Que montre chaque
expérience ? Conclure.
1.2.2 Le thymus et la moelle osseuse sont-ils des organes lymphoïdes
primaires ou secondaires ?
Indiquer leurs rôles respectifs dans la production et/ou la maturation des
cellules impliquées dans l'immunité de type spécifique.
2 Processus des coopérations cellulaires.
Ce processus est présenté dans le document 4.
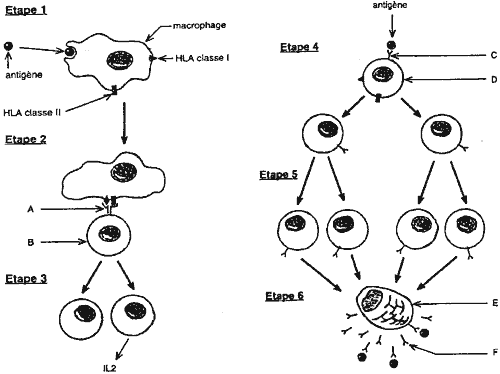
2.1 Légender sur la copie ce schéma
(fig A à F).
2.2 Décrire succinctement les étapes (1) à (6).
2.3 Que signifie le sigle IL2 ? Quel est son rôle ?
2.4 Les lymphocytes CD8, non représentés sur le schéma fourni, sont
aussi appelés lymphocytes effecteurs. Quel est le rôle de ces cellules dans le
maintien de l'intégrité de l'organisme ?
3 Perturbation des coopérations cellulaires.
Le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) a pour cible des cellules
immunocompétentes, en particulier les lymphocytes CD4.
3.1
Citer et expliciter le nom de la maladie provoquée par ce virus.
3.2 Cette maladie se traduit, entre autres, par des infections dues à
des micro-organismes opportunistes. En s'appuyant sur les processus de coopérations
cellulaires développés dans le document 4, expliquer l'apparition de ces
infections, à la suite de la multiplication du virus V.I.H.
Sujet de métropole 2003 BIOLOGIE
HUMAINE
Étude de quelques propriétés de la réponse immunitaire spécifique
L'efficacité de la réponse immunitaire spécifique repose sur la reconnaissance d'antigènes variés. On se propose d'étudier les mécanismes mis en jeu dans la reconnaissance de l'antigène, dès son arrivée dans l'organisme.
1 ÉTUDE DES ORGANES ET DES CELLULES INTERVENANT DANS LA RECONNAISSANCE INITIALE DE L'ANTIGÈNE
Après lecture attentive des expériences du document 1, répondre aux questions suivantes

1.1 Expliquer
le rôle de la colonne de billes de latex pour les expériences A, B et C.
1.2 Les antigènes I et II proviennent de bactéries. Que représentent-ils
pour les souris ?
1.3 Etude des lymphocytes injectés aux souris.
1.3.1 Une
souris irradiée à la naissance, à qui on injecte des antigènes I et II, est
incapable de produire des anticorps contre ces derniers. Interpréter, sachant
que l'irradiation détruit les cellules de la moelle osseuse.
1.3.2 En comparant ce résultat avec celui de l'expérience C,
déduire le rôle des lymphocytes injectés à la souris Z lors de l'étape 5.
1.3.3 Interpréter les résultats obtenus pour les expériences
A et B (à l'aide des réponses données aux questions précédentes). Conclure.
1.4 Lors de sa pénétration dans l'organisme, un antigène est orienté vers des organes particuliers, où des cellules prêtes à le reconnaître vont être stimulées.
1.4.1 Quelle
catégorie d'organes est capable de prendre en charge des corps étrangers qui
viennent de pénétrer dans l'organisme ? Citer deux exemples particuliers.
1.4.2 Quelle est l'appellation générale des cellules
immunitaires impliquées dans la reconnaissance de l'antigène à cette étape ?
Ces cellules sont-elles présentes chez une souris irradiée à la naissance ?
Expliquer succinctement.
1.4.3 Cette reconnaissance représente la première étape de
la réponse immunitaire spécifique. Citer, sans les développer, les étapes
suivantes aboutissant à la production d'anticorps.
2 ETUDE DES MOLECULES MISES EN JEU DANS LA RECONNAISSANCE DE L'ANTIGENE
Les lymphocytes B possèdent à leur surface des molécules capables de reconnaître un antigène donné, comme le montre le document 2.
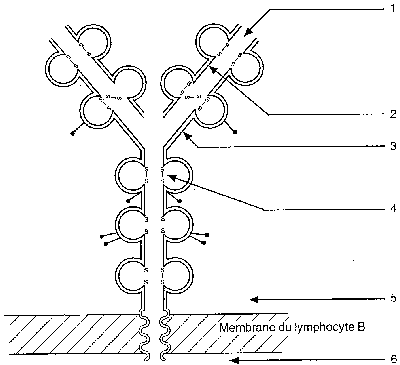
2.1 Légender
le document 2 (les légendes n°5 et 6 permettent une orientation de la molécule
par rapport à la cellule).
2.2 Donner le nom et l'abréviation de cette molécule
lorsqu'elle est associée à un lymphocyte B. Indiquer le nom et l'abréviation
de la molécule équivalente portée par les lymphocytes T.
2.3 Définir les termes « région constante » et « région
variable ».
Positionner ces régions sur le document 2.
Donner le rôle de la région variable.
2.4 Ces molécules peuvent circuler à l'état libre dans le
plasma.
2.4.1 Donner
leur nom. Citer les différentes classes possibles.
2.4.2 Certaines ont une forme pentamérique. De quelle classe
s'agit-il ? Donner sa valence. A quel stade de la réponse immunitaire est-elle
produite majoritairement ?
Sujet de métropole 2003 BIOLOGIE HUMAINE CORRECTION
Étude de quelques propriétés de la réponse immunitaire spécifique
Cette correction est une aide pour vos révisions.
Les réponses sont courtes et permettent de vous orienter pour chercher les
compléments dans vos cours ou manuels.
L'efficacité de la réponse immunitaire spécifique repose sur la
reconnaissance d'antigènes variés. On se propose d'étudier les mécanismes
mis en jeu dans la reconnaissance de l'antigène, dès son arrivée dans
l'organisme.
1 ÉTUDE DES ORGANES ET DES CELLULES INTERVENANT DANS LA RECONNAISSANCE INITIALE DE L'ANTIGÈNE

1.1 Comme
elles sont recouvertes d'Ag, elles retiennent les cellules spécifiques de ces
Ag.
1.2 Ce sont des molécules étrangères
1.3 Etude des lymphocytes injectés aux souris.
1.3.1 Les
souris irradiées sont incapables de produire des Ac. Les cellules de la moelle
osseuse sont nécessaires pour fabriquer les Ac.
1.3.2 Ce sont les lymphocytes qui sont utiles pour produire les
Ac.
1.3.3 Les lymphocytes sont spécifiques d'un Ag.
1.4 Lors de sa pénétration dans l'organisme, un antigène est orienté vers des organes particuliers, où des cellules prêtes à le reconnaître vont être stimulées.
1.4.1 Les
organes lymphoïdes secondaires comme les amygdales, ganglions, palques de
Peyer.
1.4.2 Les Cellules Présentatrices de l'Ag (CPA). Elles sont
produites par la moelle osseuse donc absentes chez une souris irradiée.
1.4.3 Reconnaissance, Sélection clonale, Stimulation et
Amplificationde B par les T4, Différenciation en plasmocytes.
2 ÉTUDE DES MOLÉCULES MISES EN JEU DANS LA RECONNAISSANCE DE L'ANTIGÈNE
Les lymphocytes B possèdent à leur surface des molécules capables de reconnaître un antigène donné, comme le montre le document 2.
2.1

2.2 Récepteur des cellules B et T respectivement BCR et TCR.
2.3 Région constante : Commune à tous les BCR de même classe
Région variable : Responsable de la reconnaissance de l'Ag (correspond au
paratope)
2.4 Ces molécules peuvent circuler à l'état libre dans le
plasma.
2.4.1
Immunoglobulines ou Ig ou Ac de classe A, D, G, E, M.
2.4.2 IgM avec 10 valences, 10 sites de fixation pour l'Ag. ils
sont produits lors de la réponse immunitaire primaire.
Sujet de remplacement 1998 BIOLOGIE HUMAINE
L'hémophilie et sa transmission (6
points)
1 L'hémophilie.
L'hémophilie affecte le mécanisme schématisé sur le document 3.

1.1 De quel mécanisme s'agit-il ?
1.2 Que représentent les éléments notés en chiffres romains ? Quelle différence existe-t-il entre les formes sans ou avec astérisque
1.3 Indiquer, sur la copie, les noms des molécules 1, 2, 3, 4 et de la voie schématisée sur le document 3.
1.4 Lorsqu'un sujet est atteint d'hémophilie, quelle(s) protéine(s) est(sont) déficiente(s) ?
2 La transmission de l'hémophilie.
Le document 4 se rapporte à la transmission de cette maladie héréditaire qui ne touche que les hommes.
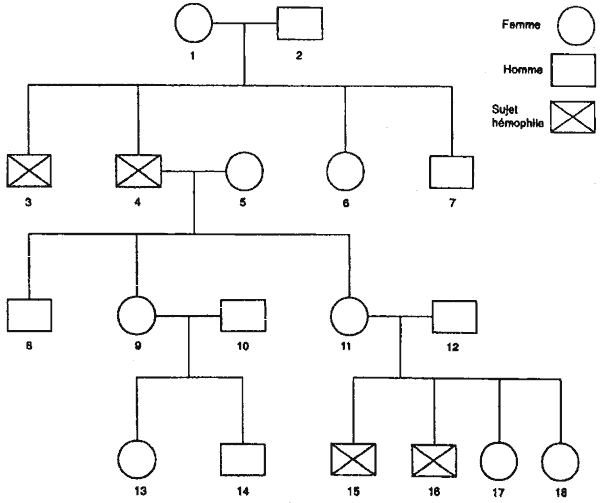
2.1 Quel est l'intérêt de l'étude des arbres généalogiques dans la génétique humaine ?
2.2 Que signifie maladie héréditaire.
2.3 Définir la notion de gène récessif. Montrer, d'après le document 4, que le gène de l'hémophilie est récessif.
2.4 De quel type d'hérédité s'agit-il ? Sur quel chromosome est porté le gène de l'hémophilie ? Justifier les réponses.
2.5 Donner le génotype des individus 4 et 7 (conventions utilisées à préciser).
2.6 On s'intéresse au groupe d'individus 11, 12, 15, 16, 17, 18.
2.6.1 Donner le(s) génotype(s) et le phénotype de chacun des quatre enfants.
2.6.2 Que peut-on dire de la femme 11.
2.6.3 À l'aide d'un échiquier de croisement, déterminer la probabilité pour le couple 11-12 d'avoir un enfant hémophile. Comparer avec la descendance du couple 11-12 et conclure.

Sujet 1999 de la Réunion BIOLOGIE HUMAINE
Le message hormonal (6 points)
L'insuline est une hormone composée de 2 chaînes constituées respectivement de 21 et 30 acides aminés réunies par des ponts disulfures. Cette hormone est sécrétée par les cellules b des îlots de Langerhans du pancréas dont la structure est schématisée dans le document 3.
1 Caractéristiques histologiques du pancréas.
1.1 Annoter le schéma (document 3 :ilots de Langerhans).
1.2 Comment peut-on classer le pancréas, au vu de son organisation histologique ?2 Caractéristiques et propriétés de l'insuline.
2.1 Définir le mot " hormone ". Du point de vue chimique, à quelle catégorie d'hormone appartient l'insuline ?
2.2 L'insuline est-elle sécrétée par les cellules A ou B du document 3 ? Justifier la réponse.
2.3 Indiquer par une flèche, sur ce document, le devenir de l'insuline libérée par les cellules sécrétrices.3 Rôle du pancréas. On réalise les expériences suivantes sur 2 chiens
hyperglycémietroubles digestifs
glycémie normale
Interpréter les résultats de ces expériences.
4 Rôle de l'insuline.
Au chien 1 (pancréatectomisé) gardé au repos, on injecte par voie intraveineuse de l'insuline radioactive (la radioactivité permet de suivre facilement la localisation de l'hormone dans l'organisme). On constate que
l'hyperglycémie disparaît
| les troubles digestifs persistent
| la radioactivité est rapidement retrouvée au niveau de la membrane
plasmique des cellules du foie, des muscles et accessoirement des
cellules adipeuses du tissu conjonctif.
| La radioactivité n'est pas décelée au niveau du cytoplasme ou du
noyau de ces cellules
| la quantité de glycogène augmente dans les cellules hépatiques et
musculaires. | |
4.1 Comment peut-on qualifier les cellules hépatiques, musculaires ou adipeuses vis-à-vis de l'insuline ?
4.2 Pourquoi l'hormone n'est retrouvée que sur ces 3 types de cellules ?
4.3 Que prouve le fait que la radioactivité ne soit retrouvée qu'à la surface de ces cellules et pas dans le cytoplasme ?
4.4 Existe-t-il un lien entre la diminution de la glycémie et l'augmentation du glycogène hépatique et musculaire ? Développer la réponse.
4.5 Rappeler le principal paramètre physiologique responsable d'une augmentation du taux d'insuline dans le sang.
4.6 Citer le nom de la principale pathologie liée à une déficience de sécrétion en insuline du pancréas.
Sujet 1999 de la Réunion BIOLOGIE HUMAINE CORRECTION
Le message hormonal
Cette correction est une aide pour vos révisions. Les réponses sont courtes et permettent de vous orienter pour chercher les compléments dans vos cours ou manuels.1 Caractéristiques histologiques du pancréas.
1.1 (probablement car le schéma est de mauvaise qualité)
- A : Acinus pancréatique
- B : Ilot de langerhans
- 1 : Vaisseaux sanguins
- 2 : Vaisseau excréteur
.
1.2 c'est une glande endocrine et exocrine
2 Caractéristiques et propriétés de l'insuline.
2.1 Hormone : messager chimique intercellulaire transporté par le sang. L'insuline est une hormone peptidique.
2.2 Par les cellules B car en contact avec les vaisseaux sanguins.
2.3 Passe dans les vaisseaux sanguins
3 Le pancréas controle la glycémie et une partie de la digestion. Les facteurs contolant la glycémie sont véhiculés par le sang contrairement aux composés (enzymes).
4 Rôle de l'insuline.
4.1 Ces cellules sont insulino-sensibles
4.2 Car elles possèdent les récepteurs spécifiques à l'insuline
4.3 L'insuline ne pénétre pas dans la cellule, les récepteurs sont
membranaires.
4.4 Oui le glucose est stocké sous forme de glycogène.
4.5 Le taux de glucose dans le sang (environ 0,9-1g/L).
4.6 Diabète.
|