 cours
introduction et grandes fonctions
cours
introduction et grandes fonctions cours
introduction et grandes fonctions
cours
introduction et grandes fonctions
PLAN
INTRODUCTION :
LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME
1.
DÉFINITION DE L’ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE
2.
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ORGANISATION STRUCTURALE DE L’ORGANISME
1.1.
Niveau chimique
1.2.
Niveau cellulaire
1.3.
Niveau tissulaire
1.4.
Niveau des organes
1.5.
Niveau des systèmes et appareils
1.6.
Niveau de l’organisme
3.
LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME
4.1. Appareil
cardio-vasculaire
4.1.1. Rôle principal
4.1.2. Organisation
4.2.
Appareil respiratoire
4.2.1. Rôle
principal
4.2.2. Organisation
4.3. L’appareil urinaire
4.3.1. Rôle
principal
4.3.2. Organisation de l’appareil urinaire
4.3.3. Élaboration
de l’urine
![]()
COURS INTRODUCTION :
LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME
1.
DÉFINITION DE L’ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE
- Anatomie :
étude de la structure et de la
forme (morphologie) du corps et de ses parties, ainsi que les relations que
celles-ci ont les unes avec les autres (ana= à travers,
temnein = découper) l’anatomie
macroscopique= étude du corps ou de ses structures visibles à l’œil nu (ex :
poumon, os)
-
Physiologie : (physio = nature, logos = étude)
étude du fonctionnement du corps et de ses parties.(//homéostasie)Ex : neurophysiologie qui étudie le fonctionnement du
syst. nerveux
2.
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ORGANISATION STRUCTURALE DE L’ORGANISME
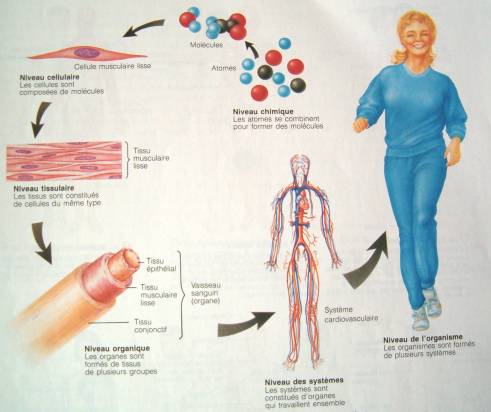
1.1. Niveau chimique
C’est le plus élémentaire : Les atomes (C, H,
N, P, O…) se combinent pour former des
molécules plus ou moins complexes (protéines, lipides,
glucides, acides. Nucléiques).
1.2. Niveau cellulaire
Les molécules se combinent entre elles de façon spécifique pour former des
cellules.
Une cellule est la plus petite unité structurale et
fonctionnelle de base d’un organisme vivant.
Toutes les cellules d’un organisme humain ne sont pas identiques : elles
sont différenciées : si elles expriment et
utilisent des parties différentes de leur génome, elles auront des fonctions
différentes et une structure différente.
Étude anatomique des cellules = cytologie
1.3.
Niveau tissulaire
Un tissu est constitué par l’association de cellules semblables, qui
remplissent ensemble une même fonction.
Il existe 4 groupes de tissus chez l’homme qui jouent des rôle particuliers
et distincts :
-
Le tissu épithélial (recouvrement des surfaces externes et
internes)
-
Le tissu conjonctif (remplissage, soutien, protection)
-
Le tissu musculaire (permet le mouvement) : muscles
squelettiques striés, muscles lisses viscéraux, muscles strié cardiaque
-
Le tissu nerveux (coordonne les activités corporelles)
Étude anatomique des tissus = histologie
1.4.
Niveau des organes
Résulte de l’association de différents tissus qui permet de former les
organes.
Un organe masse
bien individualisée dans l’organisme, formée par plusieurs tissus différents
et qui assurent un ou plusieurs fonctions bien définies.
1.5.
Niveau des systèmes et appareils
Un appareil (ou système) regroupe les différents tissus et organes qui
assurent ensemble une même fonction. Voir polycopié
sur les différents systèmes de l’organisme
1.6.
Niveau de l’organisme
L’organisme est formé de 11 systèmes
3.
LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME
|
FONCTIONS |
PRINCIPAUX
RÔLE |
APPAREILS
OU SYSTÈMES |
|
|
Fonctions
de relation |
Permet
d’enregistrer les variations du milieu extérieur de réagir à ses
variations et de se déplacer dans ce milieu |
Mouvement |
Syst.
nerveux, syst. musculaire, syst. osseux |
|
Perception
d’informations |
Syst.
nerveux, syst. tégumentaire |
||
|
Contrôle
et coordination |
Syst.
nerveux, syst. endocrinien, app. cardiovasculaire |
||
|
Protection
du milieu intérieur |
Syst.
lymphatique, syst. immunitaire |
||
|
Fonction
de nutrition |
Assurent
l’apport aux différents organes des substances indispensables au
fonctionnement de leurs cellules |
App.
Digestif, app. Respiratoire, app. cardiovasculaire |
|
|
Fonction
d’excrétion |
Éliminent
du corps les différentes sortes de « déchets » qui se
forment à la suite de son fonctionnement |
App.
Digestif, app. respiratoire, app. Urinaire, ap. cardiovasculaire |
|
|
Fonction
de reproduction |
Rôle
dans la perpétuation de l’espèce |
App.
génital, syst. endocrinien, syst. nerveux |
|
Travail personnel :
- Répertorier les appareils ou systèmes participant à chaque grande fonction
- A l’aide de vos documents personnels de 1ère STL et Term STL
le tableau suivant en indiquant pour chaque appareil ou système son ou
ses rôles ainsi que ses principaux constituants
|
APPAREIL
OU SYSTÈME |
ORGANES
ET TISSUS PRINCIPAUX |
PRINCIPAUX
RÔLES |
FONCTIONS |
|
tégumentaire |
Peau
+ glandes épidermiques (sudoripares et sébacé) |
-Protection
de l’organisme -Perception
de stimulus Régulation
thermique -synthèse
vit D |
Relation |
|
Respiratoire |
Fosses
nasales, pharynx, larynx, trachée, broches, les poumons |
-Échange de gaz resp. avec m. extérieur
-Régulation du pH sanguin |
Nutrition
Excrétion |
|
Digestif |
Cavité
buccale, pharynx, œsophage, estomac, intestin, rectum, glandes
salivaires, foie et pancréas |
-Dégradation des aliments ingérés
-Absorption des nutriments
-Élimination de certains déchets |
Nutrition
Excrétion |
|
Urinaire |
2
reins 2 urètres 1 vessie et 1 urètre |
-Filtration du plasma et élimination des déchets
-Constance du vol, [ ], pH du sang |
Excrétion Osmorégulation |
|
Reproducteur |
Gonades
(2 testicules ou ovaires) Voies
génitales + glandes diverses Conduisant
aux org génitaux externes |
-Production
et émission des gamètes (spz, ovules) -Production
d’hormones (testostérone, œstrogène, progestérone) -Rapprochement
des gamètes et Fécondation -Gestation
chez la femme |
Reproduction |
|
Cardiovasculaire |
Cœur,
vx sg, sg ; voix lymphatiques, lymphe canalisée |
-Distribution du sang
-Fonction immunitaire et hémostatiques
-Transport différentes molécules
-Régulation thermique de l’organisme |
Relation Relation
défense Nutrition Relation
contrôle |
|
Nerveux |
Encéphale,
moelle ep, nerfs et organes sensoriels |
-Perception
d’information, stimulus -Réaction
aux changement int et ext -Coordination
entre les différents organes -État
de veille ou de sommeil |
Relation
coordination |
|
Endocrinien |
Glandes
endocrines (thyroïde,
surrénales, pancréas, gonades..) |
-Régulation de différents processus (croissance
reproduction…) |
Coordination
entre les organes |
|
Musculaire |
Muscles
squelettiques, viscéraux et cardiaque |
Mouvement du corps, posture, production de chaleur |
Relation
(locomotion) |
|
osseux |
Os,
cartilages, articulation |
Protection
et soutien des organes
Appui des muscles :mouvement Lieu
de synthèse des cellules sanguines |
Locomotion |
|
immunitaire |
Cellules
de l’immunité + tissus et organes lymphoïdes MO, thymus, GGL, rate… |
Protection contre agressions microbiennes et comme
des modifications des constituants de l’organisme |
Relation |
4. ÉTUDE DE QUELQUES APPAREILS
4.1.
Appareil
cardio-vasculaire
4.1.1. Rôle principal
Assurer la distribution du sang dans l’organisme.
4.1.2. Organisation
|
LE
Cœur
|
-
c’est un muscle creux assurant l’éjection du sang dans
le système vasculaire Lorsque la pression
ventriculaire devient inférieure à la pression artérielle, les valvules
sigmoïdes se referment afin d’éviter le reflux du sang vers le cœur.
|
|
LES
VAISSEAUX SANGUINS Le diamètre des vaisseaux varie entre quelques
micromètres et 3 centimètres. On repère ainsi différents types de
segments vasculaires |
- les artères et artérioles : permettent la distribution du sang provenant du cœur vers les différents territoires de l’organisme. Les parois des artères sont résistantes et élastiques, la pression sanguine et la vitesse de circulation du sang sont élevées. Pas d’échanges. Le réseau artériel assure donc le transport rapide du sang vers les organes
Caractéristiques
d’une surface d’échange efficace
|
|
LES
VAISSEAUX LYMPHATIQUES |
Ils recueillent le liquide qui s’accule dans les tissus et assument son retour vers le compartiment sanguin. (cf chapitre 1)
|
4.2.
Appareil respiratoire
4.2.1. Rôle
principal
Assure
les échanges gazeux en captant le dioxygène (O2) dans l’air
et en y rejetant le dioxyde de carbone (CO2).
4.2.2. Organisation
L’appareil respiratoire est constitué par :
-
les voies aériennes : fosses nasales, pharynx, larynx , trachée, bronches et
bronchioles
-
les poumons : situés dans la cage thoracique et limités ventralement par le
diaphragme, sont enveloppés par les plèvres, paroi repliées sur elles-même
et contenant un liquide.
Les bronchioles des voies aériennes se terminent par
des petits « sac à air » hémisphériques qui sont les alvéoles
pulmonaires. Les poumons sont en fait constitués par ces alvéoles qui forment
un ensemble spongieux.
o
Les voies aériennes zone de conduction :
Les voies aériennes constituent la zone de conduction de l’air qui relient
l’air atmosphérique et l’air alvéolaire.
De plus, sur son trajet l’air inspiré est progressivement réchauffé et
hydraté au contact des cellules épithéliales et «dépoussiéré »
par un ensemble cilio-muqueux qui fixe les particules de l’air (poussières,
pollens, microorganismes…)
Remarque : il n’y pas d’échanges gazeux à ce niveau
o
La paroi alvéolaire zone d’échanges gazeux :
La paroi des alvéoles pulmonaires constitue la zone respiratoire où
s’effectuent les échanges gazeux entre l’air alvéolaire et le
sang.
Ces échanges gazeux s’effectuent par diffusion à travers la paroi
alvéolaire.
La paroi alvéolaire représente une zone d’échange très efficace :
-surface importante (70 m2 / poumon ) »
surface d’un court de tennis
-faible épaisseur
(0.1
à 0.4 µm)
-richement vascularisée
-diffusion des gaz rapide
La paroi alvéolaire est constituée de plusieurs types cellulaires présentant
des propriétés remarquables :
-
Les cellules épithéliales appelées pneumocytes I qui
sont des cellules du revêtement de la paroi et constituent l’essentiel de
cette dernière.
-
Les macrophages qui ont un rôle dans les mécanismes de défense
-
Les pneumocytes II qui sont dispersés dans la paroi et sécrètent
le surfactant. Ce surfactant forme un film continu à la surface des alvéoles
évitant ainsi qu’elles se replient sur elles-même et freinent la réalisation
des échanges.
Remarque :
les pneumocytes II ne sont effectifs qu’à la fin de la vie fœtale. Ce qui
fait que certains prématurés, ne
disposant pas encore de surfactant, présentent un syndrome de détresse
respiratoire.
N.B : Les réseaux vasculaires (capillaires) et
pulmonaires (alvéoles) sont en étroite relation pour la réalisation des échanges
gazeux.
4.3.
L’appareil urinaire
4.3.1. Rôle
principal
élaboration
de l’urine. Les reins filtrent le plasma (= portion liquide du sang (eau + électrolytes +
protéines + gaz + nutriments + produits de déchets + hormones)) et permet l’élimination
des déchets toxiques ; ils permettent également de régler la
concentration et le volume sanguin et ils contribuent à régler le pH du sang.
4.3.2. Organisation de l’appareil urinaire
| Ses différentes composantes: |
-
Deux
reins qui élaborent
l’urine définitive. Chaque rein contient 1 à 1,2 millions de tubules rénaux
appelés néphrons. Ceux-ci sont très richement vascularisés et c’est
à leur niveau que l’urine est fabriquée.
- Deux uretères
qui relient les reins à la vessie. L’urine produite par les néphrons est
recueillie dans le bassinet puis elle s’écoule par les deux uretères vers la
vessie.
- Une vessie qui permet le stockage de l’urine
- Un urètre qui permet l’évacuation de l’urine.
| Sa vascularisation : |
Chaque reins est irrigué par une artère rénale ( en provenance de l’artère aorte) et d’une veine rénale (rejoignant la veine cave inférieure).
4.3.3. l'Élaboration de l’urine
La formation de l’urine dans le néphron a été étudiée grâce à la méthode des microponctions. Cette méthode consiste a prélever à différents niveaux du néphron à l’aide d’une micropipette, et mesurer les concentrations et débits des substances étudiées.
Cette étude a mis en évidence 3 étapes majeures dans la
formation de l’urine:
-une étape glomérulaire de filtration
-une étape tubulaire de réabsorption
-une étape tubulaire de sécrétion
La quantité d’une molécule qui est éliminée dans l’urine finale est la
quantité filtrée plus la quantité sécrétée par le tube moins la quantité
réabsorbée par le tube.
Pour une substance A, on peut dire que:
A urinaire
= A filtré + A sécrétée – A réabsorbé
Schéma
général :
les 3 composantes de la fonction rénale
| la filtration glomérulaire |
Elle permet la formation de l’urine primitive
par filtration du plasma (Urine primitive = filtrat de plasma).
La concentration en soluté est quasiment la même dans le plasma et urine
primitive sauf pour les molécules les plus grosses ( protéines
plasmatiques, calcium et lipides qui sont liés aux protéines poids moléculaire
> à 10 000 Daltons) qui ne sont pas filtrées.
La possibilité pour une molécule de traverser le filtre rénal est déterminée
par sa taille (poids moléculaire = PM)
et par sa charge électrique (
les molécules électropositives sont filtrées plus facilement que les molécules
électronégatives).
Pour les molécules dont la structure permet une filtration, la quantité filtrée
dépend du jeu des pressions de part et d’autre de la membrane filtrante. La
pression hydrostatique du sang favorise la filtration, la pression hydrostatique
de la capsule de Bowman et la pression colloïdale osmotique des protéines
plasmatiques du sang s’opposent à la filtration.
Schéma :
jeu des pressions intervenant dans la filtration glomérulaire
- Quelques définitions….
P. hydrostatique (P h )
= P exercée par une colonne de liquide sur les surfaces avec lesquelles elle
est en contact
Ex : dans le cas des vaisseaux sanguins, il s’agit de la P exercée sur
les vaisseaux par le sang
P. colloïdale osmotique (P col ) =
P exercée par les molécules sur une membrane qu’elles ne peuvent pas
traverser.
Ex : protéines présentent dans le plasma et qui ne peuvent pas traverser
la membrane filtrante
la pression de filtration
nette (P
filtration) = P h sang – P col – P h
capsule
Schéma :
les 3 modes possibles de traitement rénal de substances
| la réabsorption tubulaire |
la réabsorption tubulaire est un élément essentiel de
la fonction rénale. Elle permet d’éviter la perte de substances
importantes pour l’organisme comme l’eau, le glucose, les acides aminés
et certains électrolytes, qui sont très abondants dans l’urine primitive. La
réabsorption tubulaire est sélective.
Ex : elles est très importante pour le glucose qui est réabsorbé à
100%, mais nulle pour certains déchets métaboliques comme la créatinine, qui
n’est pas réabsorbée du tout.
Les ions sont en grande partie réabsorbés, mais le plus souvent par transport actif, par échange d’ions entre le sang et l’urine. Ainsi, le sodium est réabsorbé en échange d’une sécrétion d’ions K+ et H+. les ions bicarbonate, responsables du maintien du pH du sang sont réabsorbés en échange d’ions H+ ou d’autres charges acides comme les ions ammonium (NH4+).
| la sécrétion tubulaire |
la sécrétion est souvent couplée avec la réabsorption.
Elle concerne les charges acides (H+ et NH4+), le rein ayant un rôle essentiel
dans le contrôle du pH sanguin.
Conclusion : Au final on obtient l’urine :
-
liquide jaunâtre
-
pH allant de 4,7 à 6
-
volume urine/j = diurèse = 1,5 L/j
-
contient 30 à 70 g de substances dissoutes/L
-
dépourvue de glucose et de protéines dans les conditions normales
![]()
MOTS
CLES ET Définitions SUR LA PARTIE
INTRODUCTION :
LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME
-
Anatomie :
étude
de la structure et de la forme (morphologie) du corps et de ses parties, ainsi
que les relations que celles-ci ont les unes avec les autres (ana=
à travers, temnein = découper)
l’anatomie macroscopique= étude du corps ou de ses structures visibles
à l’œil nu (ex : poumon, os).
-
Physiologie :
(phusio = nature, logos = étude) étude du fonctionnement du corps et de ses
parties.
Ex : neurophysiologie qui étudie le fonctionnement du syst.
Nerveux.
-
Cellule :
c’est la plus petite unité structurale et fonctionnelle de base d’un
organisme vivant.
-
Cytologie :
Etude des cellules.
-
Tissu :
il est constitué par
l’association de cellules différenciées de même type (semblables),
qui remplissent ensemble une même fonction. Il existe 4 groupes de
tissus chez l’homme jouant des rôles particuliers et distincts :le tissu
épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire, le tissu nerveux.
-
Histologie :
Etude des tissus.
-
Conjonctif :
se dit d’un tissu ou de cellules qui jouent un rôle de remplissage ou de
soutien.
-
Epithélial :
se dit d’un tissu ou de cellules qui recouvrent le corps ou certains organes
et tapissent les cavités corporelles.
-
Musculaire :
se dit d’un tissu ou de cellules capables de contraction.
-
Nerveux :
se dit d’un tissu ou de cellules qui assurent la perception d’informations
intérieures et extérieures au corps et la coordination entre organes.
-
Organe :
c’est une masse bien individualisée dans l’organisme, formée par plusieurs
tissus différents et qui assurent une ou plusieurs fonctions bien définies.
-
Appareil
(ou Système) :
il regroupe des tissus et organes qui assurent ensemble une même fonction.
Appareil :ensemble
d’organes concourant à la réalisation d’une même fonction.
Système : ensemble
d’éléments similaires de l’organisme et participant à une même
fonction.
-
Organisme :
c’est un ensemble formé de 11 systèmes.
-
Artère :
vaisseaux sanguin qui
permet la distribution
du sang provenant du cœur vers les différents territoires de l’organisme.
-
Veines :
vaisseaux sanguin qui collectent le sang sortant des
capillaires et assurent le retour du sang vers le cœur.
-
Capillaires
sanguins :
ils
constituent une zone d’échange entre le sang et les tissus. (voir caractéristiques dans zone d’échange
efficace).
-
Zone d’échange efficace : Perméable
pour permettre le passage des molécules transportées par le sang, Surface
importante pour qu’il est une quantité de molécules échangées
suffisante, Très fine pour que les échanges soient aisés, (+ autres
caractéristiques propre à chaque surface d’échange respiratoire, « urinaire »…).
-
Hormone : substance chimique sécrétée par une cellule endocrine et qui, véhiculée
par le sang, exerce à distance une action spécifique sur d’autres cellules.
-
Exocrine : se dit d’une glande qui rejette ses produits de sécrétion par la
peau ou dans les cavités naturelles de l’organisme.
-
Absorption : mécanisme de transport d’une substance vers le
milieu intérieur de l’organisme.
-
Alvéoles : petits « sac à air » situés à l’extrémité de
l’arbre bronchique. Siège des échanges gazeux entre l’air alvéolaire et
le sang.
-
Pneumocytes : cellule de l’épithélium pulmonaire. Les
pneumocytes I constituent les vraies cellules de revêtement de la paroi alvéolaire.
Les pneumocytes II, dispersés dans la paroi, sécrètent le surfactant.
-
Surfactant : Mélange de phospholipides (90%) et de protéines
(10%) élaboré par les pneumocytes II. Cette substance tensioactive maintient
l’ouverture des alvéoles.
-
Valvules : ensemble conjonctif réglant le passage du sang entre
les chambres cardiaques, et entre les ventricules et les tronc artériels. (les
valvules auriculo–ventriculaires empêchent le refoulement du sang des
ventricules vers les oreillettes une fois qu’il est dans les ventricules, idem
pour valvules sigmoïdes, elles empêchent que le sang refoule des artères vers
les ventricules une fois qu’il est dans les artères).
-
Système porte-hépatique : réseau veineux associant les capillaires de
l’intestin aux capillaires du foie.
-
Filtration glomérulaire :mouvement du plasma, sans ses protéines, vers
l’espace de la capsule de Bowman. Produit le filtrat glomérulaire, ou urine
primitive.
-
Filtration :mouvement de l’eau et des solutés à travers une
membrane semi-perméable d’une région de P.hydrostatique élevée vers une région
de P.hydrostatique plus faible, c’est à dire dans le sens du gradient de
pression.
-
Néphron : unité fonctionnelle du rein, comportant un glomérule et un tubule.
-
Réabsorption tubulaire :mouvement de certaines substances du liquide
intratubulaire vers le plasma des capillaires péritubulaires.
-
Sécrétion tubulaire : mouvement de certaines substances du plasma des
capillaires péritubulaires vers le liquide intratubulaire.
-
Glomérule : site de filtration du sang au niveau du néphron,
constitué d’un bouquet de capillaires pelotonnés et appliqués à l’extrémité
borgne et élargie du néphron.
-
Tubule : ensemble du tube urinifère très vascularisé, siège de réabsorptions
ou de sécrétions entre le liquide intratubulaire et le plasma sanguin.
-
Diffusion : mouvement d’une région à forte concentration
vers une région à faible concentration.
-
Osmose : correspond à la diffusion
nette de l’eau d’une zone riche en eau vers une zone pauvre en eau. Pour
cela, il faut l’existence d’un gradient de concentration qui produit un flux
net. Ainsi, le solvant (eau) passe de la solution la moins concentrée à la
plus concentrée pour rétablir un équilibre des concentrations. (voir schéma expérience eau/glucose dans
tubes en U) .
- Pression oncotique : pression exercée par les grosses molécules du sang sur les liquides extravasculaires, à travers la paroi des vaisseaux. Ces grosses molécules (prot. Plasmatiques) ne peuvent pas diffuser (à travers mbre capillaire) et attirent l’eau.
- Pression osmotique : pression développée par une solution pur, dont elle est séparée par une membrane semi-perméable, et qui détermine l’osmose.
![]()
|
|
|
|
Introduction les grandes fonctions de l'organisme
|
Présenter de façon schématique les différentes fonctions de l'organisme en les reliant aux connaissances acquises sur l'organisation générale de ces appareils (cf programme de première)
|